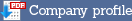Qui gouverne en Tunisie depuis les élections de 2014 ?
11/12/2016
Qui gouverne? C’est une question que les Tunisiens ne cessent de se poser légitimement depuis les élections de 2014. On est passé du sur-pouvoir d’Ennahdha dans la troïka au sous-pouvoir de Nida Tounès, pourtant voué au « taghawal » avec sa mainmise électorale sur le parlement, le gouvernement et la présidence. Une phase aggravée par la scission de Nida, compliquée par le gouvernement Essid et recousue par l’accord de Carthage et le gouvernement d’union nationale. En tout cas, le paysage politique paraît aux Tunisiens de plus en plus étonnant, voire incongru. Les hommes font certes toujours le régime et les institutions, mais jusqu’à une certaine limite à ne pas franchir.
Le pays est passé du pluralisme de type autoritaire sous Ben Ali au pluralisme de type anarchique sous la transition. Un pluralisme sans aucune autorité incontestable veillant au grain. Pire, il y a trop d’autorités « effectives », et même puissantes, visibles ou invisibles, légales ou occultes. « Trop de bien nuit », trop d’autorités aussi. Dire qu’on est en transition démocratique, un système qui fait éclater les autorités traditionnelles tout en tentant d’y substituer de nouvelles, ne suffit plus aujourd’hui. Même les transitions démocratiques peuvent s’accorder sur l’autorité légitime et effective. Encore faut-il, il est vrai, avoir un régime cohérent. Qui gouverne alors à défaut d’une autorité reconnue, visible et incontestée ? En fait, les choses sont loin d’être simples.
1) Le Président Béji Caïd Essebsi ? Il est vrai que, même s’il n’a pas retrouvé un régime politique à sa mesure, convenant à sa stature politique, Essebsi est assez réaliste pour « s’arranger » avec n’importe quel régime qui lui est offert, en essayant de le façonner à sa mesure. Il y a presque réussi, puisqu’il a pu présidentialiser un régime parlementaire, et il faut le faire. Si Nida était resté solide, il serait même devenu l’autorité gouvernante majeure, même si le nouveau régime accorde la prééminence constitutionnelle au chef de gouvernement. L’expérience politique et le charisme d’Essebsi lui ont permis de faire la différence face à une classe politique qui, pour sa grande majorité, est peu affutée à la chose politique. Une classe avide de bavardages médiatisés et de luttes de personnes, plutôt que de conquêtes, de maintien, de renforcement du pouvoir ou de recherche de bons équilibres politiques. L’amateurisme de la classe politique a accentué l’autorité d’Essebsi. Ils se chamaillent, ils vont droit au mur, et quand la situation est bloquée, ils recourent au président. Ce n’est pas un hasard si Ghannouchi et l’Ugtt restent certainement les deux seuls contrepouvoirs à même de contrecarrer son action.
2)Le cheikh Ghannouchi ? Il est à coup sûr un des hommes clés de la transition. L’homme s’emporte peu, il est patient et n’improvise pas. Il calcule froidement pendant que les autres s’agitent. Chose qu’il partage en commun avec Essebsi. Même quand il est silencieux, il semble marquer de nouveaux territoires ou élaborer de nouvelles stratégies porteuses. L’influence, il en a, comme le prouvent, à la fois, le succès électoral rapide d’Ennahdha en 2011, le contenu de la Constitution, le Dialogue national, l’échec réussi de 2014 et la mutation idéologique de son parti contre certains barons du parti. L’homme est aussi déterminé que tenace. C’est un réaliste qui sait faire des concessions et attendre son heure. En matière d’équilibre politique, il faut compter avec lui. C’est un théologien qui sait lire les chiffres, surtout quand ils sont en sa faveur. La menace du théologien est toujours implicite. Il ne donne rien sans rien. Quand on touche à ses « dogmes », il agit par des chantages détournés (influence sur des juges fidèles, mosquées, ligues de protection, journalistes, médias, communiqués menaçants, rébellion parlementaire). Pour le reste, il est droit comme un « i » : pro-institutions et pro-démocratie.
3)Le duo Essebsi-Ghannouchi ? Le duo des amis-ennemis, qui tente de fusionner dans la mesure du possible l’islamisme et le modernisme dans une étape confuse et complexe, pour « le bien du pays », notamment depuis l’assassinat de Mohamed Brahmi et le dialogue national. En langage wébérien, c’est la fusion de l’autorité rationnelle-légale (Essebsi) et de l’autorité traditionnelle (le cheikh). Tous les deux composent une sorte de « gouvernement de fait », qui nous rappelle celui dont parlait Henri Kissinger dans son sa thèse, Le chemin de la paix, lorsque l’Europe des nations était dirigée au début du XIXe siècle, par un directoire autour de trois diplomates chevronnés : Metternich (Autriche), Castlereagh (Angleterre) et Talleyrand (France), professant quelques bonnes idées simples d’équilibre politique. L’équilibre, c’est ce qui intéresse le duo Essebsi-Ghannouchi pour gérer un évident rapport des forces. Ils sont tous les deux pragmatiques et « animaux politiques ». Avoir des garanties de gouvernement pour l’un (Essebsi) contre une recomposition durable pour l’autre (Ghannouchi).
Deux failles à ce « gouvernement de fait » de la Tunisie. D’abord, l’association Essebsi-Ghannouchi est toujours mal perçue par les modernistes et par les électrices d’Essebsi, même si la classe politique reconnaît son utilité, du moins pour le moment, dans la quête de paix civile et de stabilité politique. Ensuite, le duo est de plus en plus débordé par l’Ugtt, par certains courants de Nida et par les forces occultes, outre le fait que les deux personnages ne sont pas toujours sur la même longueur d’onde et que la méfiance réciproque règne imperturbablement entre eux. Au-delà de leur consensus forcé, Essebsi est toujours à la recherche d’une alternative à son parti et au pays et Ghannouchi à un moyen de riposte et de chantage. Tous les deux sont « d’accord sur leurs arrière-pensées », comme l’aurait dit le Général de Gaulle.
4) La majorité nidéiste ? Nida croyait gagner la guerre en 2014, il n’a remporté qu’une bataille éphémère. Aussitôt vainqueur, aussitôt défait. A la suite de la scission précoce de MachrouTounès, le premier parti de Tunisie se trouve à la merci de son second direct, Ennahdha. Nida perd sa majorité au parlement. Normalement, comme dans les régimes parlementaires, le parlement aurait dû être renvoyé à ses chers électeurs. Il n’en est rien. La Constitution est trop compliquée à ce sujet.
D’où l’artifice politique qui gouverne la Tunisie. Le parti majoritaire n’a plus les moyens de gouverner majoritairement le pays. N’eut été la présence de son leader, Essebsi, à la présidence, le parti se serait effrité. La présence du fils du président, parachuté par la famille parmi les dirigeants du parti, et l’obstination à refuser le recours à un congrès légitimant la direction du parti, qui aurait résolu tous les problèmes, a tout fait voler en éclats. Aujourd’hui, le parti est plus que scindé en deux. Il est lui-même en déliquescence, voué désormais non pas à la politique, mais plutôt au combat de boxe. Le comble, c’est qu’il est toujours le favori des sondages d’opinion. Il est toujours considéré comme le seul refuge contre les islamistes. C’est le vote « contre » des modernistes qui prime. On vote moins pour Béji, que contre les islamistes. Un appui à demi-regret. C’est la seule « force » qui reste à Nida.
L’Ugtt ? Ce syndicat s’est mis à rêver. Il est même devenu trop gourmand face à la déliquescence de l’Etat. Sa légitimité révolutionnaire, son Dialogue national et son Nobel lui ont donné des ailes. Il a toujours confondu l’intérêt sectoriel et l’intérêt national. Il veut être les deux, il veut être partout : syndicat et parti politique, pouvoir et contre-pouvoir. Il en a toujours été ainsi, historiquement parlant. On l’invite à l’accord de Carthage, pour renforcer le consensus, il en sort pour faire des menaces de grève et de paralysie générale, pour peu qu’on touche aux salaires des syndiqués et des travailleurs. C’est vrai que l’accord de Carthage a promis de verser des augmentations salariales en 2017, mais le gouvernement, désargenté, coincé par ses engagements vis-à-vis du FMI et autres instances financières internationales sur la réduction des dépenses publiques, propose de reporter le versement des salaires. Le syndicat n’obtempère pas.
L’Ugtt, veut aujourd’hui gouverner. Empêcher de gouverner ne le satisfait plus. Le syndicat propose des projets de loi, ordonne de modifier la loi de finances, s’immisce dans la vie des partis, veut persécuter les corrompus. On a une Ugtt à la fois gouvernement, opposition, parlement, justice. Le régime parlementaire et l’effritement de l’autorité politique ont aussi contribué à faire jouer à l’Ugtt un rôle de premier plan. Elle profite du délabrement politique général : absence de parti prédominant, des islamistes toujours contestés par l’opinion, un président-arbitre et un parlement « partitocratisé ». La nature a horreur du vide.
Le chef de gouvernement ? Voué à être le nouveau chef suprême du pays, comme le voulait la nouvelle Constitution, le chef du gouvernement est victime d’emblée d’une sorte de « coup d’Etat » constitutionnel. Le leader du parti majoritaire préfère la présidence. Donc, le chef du gouvernement sera inévitablement l’homme du président. Pas le chef de la majorité, comme l’exigent les régimes parlementaires. Habib Essid était un non-politique, un neutre neutralisé, Youssef Chahed est l’homme de confiance du président, qui représente, lui, le parti majoritaire. Les deux chefs de gouvernent sont portés à gouverner techniquement ou administrativement, mais peu politiquement. Peut-être que Chahed sera relativement plus politique, plus libéré qu’Essid, étant plus lié au président. Pour l’instant les limites du chef du gouvernement sont tracées par le fondateur du parti, Essebsi, par les contraintes de l’accord de Carthage et du gouvernement d’union nationale. L’empreinte du chef du gouvernement est fonction de ses rapports tiraillés entre le président, l’Ugtt, la majorité au parlement et l’opinion.
Les forces occultes ? Qui sont-elles, que font-elles ? Les forces occultes sont une nébuleuse. Tout le monde croit les connaître, personne ne les voit vraiment. Elles n’en existent pas moins. On peut à la limite en avoir des indices, mais on n’arrive pas toujours à prouver leur présence ou leur force. Tous les Tunisiens sont révoltés contre les réseaux de corruption, qui gangrènent la volonté politique et les choix fondamentaux du pays. Qui achète les députés en payant un prix fort ? Qui finance certains gros partis politiques ? Qui fait obstacle à l’adoption d’un projet de loi important ? Qui détient légalement ou de fait les chaînes de télévision et les médias de masse ? Qui se paye des journalistes, des animateurs de télévision ou des articles de complaisance ? Qui cherche à orienter la politique du pays dans le sens de ses intérêts personnels ? Qui finance le marché parallèle et la fuite des produits en Libye ? Qui achète les juges ? Qui fait agiter les ligues ? Qui manipule les questions budgétaires ?
La politique n’arrive pas à avoir le dernier mot sur plusieurs chapitres de l’action de l’Etat à cause de ces forces occultes. La justice non plus, malgré les innombrables plaintes portées devant elle. Les forces occultes constituent bien en Tunisie une réalité irréelle, impalpable, un pouvoir occulté.
Qui gouverne en Tunisie depuis les élections de 2014 ? Tous ces pouvoirs et personne. Malin est celui qui arrive à le dire avec exactitude, à déchiffrer la portée de l’influence des uns sur les autres, à faire la part du légal et de l’occulte, du visible et de l’invisible, du sain et du malsain chez les différents pouvoirs qui se heurtent dans l’incertitude transitionnelle. Est-ce forcément cela la transition ? L’éclatement du pouvoir, faut-il noter, n’est ni la modération, ni la limitation du pouvoir. Il en est la négation. Même un dirigeant autoritaire ne s’y retrouverait pas dans ce régime chaotique qui gagnerait à être clarifié.
Lapress.tn